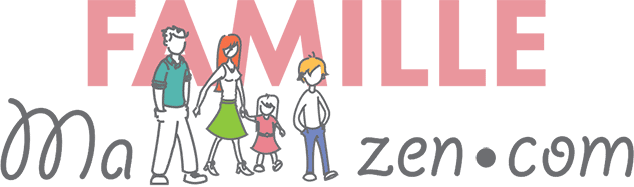Longtemps invisibilisées, les difficultés ou différences d’apprentissage chez les élèves focalisent désormais l’attention des parents et des enseignants, et débouchent souvent sur des diagnostics de neuroatypie. Ces derniers sont-ils tous justifiés ? Et le fait qu’ils soient posés s’avère-t-il salutaire? On s’interroge à ce sujet avec la thérapeute Emmanuelle Piquet, autrice de plusieurs ouvrages, notamment de Nos enfants sous microscope, TDAH/H, hauts potentiels, multi-dys & Cie : comment stopper l’épidémie de diagnostic, paru en 2021.
Ce n’est pas une augmentation mais une véritable explosion ! Le nombre de diagnostics de troubles du neurodéveloppement (neuroatypie) ou de bilans qui mettent en évidence des capacités supérieures à la normale bondit actuellement. Le TDAH / H ( trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) concernerait ainsi autour de 6 % des élèves. On recenserait la même proportion d’enfants « dys », parmi lesquels 4 à 5 % seraient dyslexiques (les enfants dys peinent à faire l’acquisition du langage écrit), une famille qui compte aussi les dysphasies, les dyspraxies, les dysorthographies, les dysgraphies et les dyscalculies. Enfin, les hauts potentiels intellectuels (HPI), qu’a mis en lumière la série du même nom, et qui désignent les enfants dont le QI est supérieur à 130, engloberaient environ 2 % de cette catégorie d’âge.
Neuroatypie : une approche différente de l’enfance
S’illustrant également dans l’infinité d’articles et d’ouvrages qui leur est consacrée, cette montée en flèche des enfants neuroatypiques diagnostiqués TDAH, DYS ou HPI s’explique, selon Emmanuelle Piquet, psychopraticienne en thérapie brève et spécialiste de la lutte contre le harcèlement scolaire, par un changement de paradigme dans les relations familiales. « Depuis Françoise Dolto, on a mis l’enfant au centre des préoccupations parentales. Du coup, ils sont très différents de ceux des années 50 et on ne peut que s’en réjouir. », note-t-elle. Car les petits, comme les grands, qui avaient autrefois des besoins éducatifs particuliers (BEP) ne disposaient d’aucun autre choix que se fondre quoi qu’il leur coutait dans la masse et la norme.
Aujourd’hui, tout a changé : il n’est pas rare qu’on trouve deux, trois profils de ce type voire davantage, par classe. Or, cette progression exponentielle d’enfants neuroatypiques ne va pas sans susciter chez les experts en santé mentale une forme d’inquiétude…. Car si de meilleurs égards accordés aux singularités de chacun, et l’élaboration d’un plan d’accompagnement personnalisé à l’école lorsque c’est véritablement nécessaire, sont évidemment souhaitables, le fait de médicaliser systématiquement les élèves en question ne s’avère pas forcément bénéfique. « Depuis quinze ans, ce qu’on constate, ce qu’il y a dans chaque édition du DSM, le manuel qui décrit et classifie les troubles mentaux, de nouvelles pathologies. Or, les parents œuvrent beaucoup pour qu’elles soient reconnues comme des handicaps. Ce qui n’est pas anodin. Car est-ce que le fait d’être diagnostiqué rassénère les enfants ? La réponse est ambivalente et tend plutôt vers le non. On en reçoit beaucoup qui le sont et restent toujours en souffrance. Et ils encombrent des services au détriment de patients qui, eux, mériteraient d’y être suivis », déplore Emmanuelle Piquet.
Le risque d’une intégration plus difficile
Car l’étiquette qu’on accole aux enfants neuroatypiques à la suite de ces diagnostics peut les enfermer plutôt que les libérer. Elle est en effet susceptible de les empêcher de déployer certains des leviers d’adaptation dont ils disposent pourtant intrinsèquement. « Ça crée une position invalidante. Quand on est regardé comme problématique, on le devient et ça les coupe de leurs ressources. Dans un premier temps, ça réconforte mais ça les essentialise ensuite comme handicapés », développe Emmanuelle Piquet, qui précise qu’il lui semble plus utile de donner les armes, d’outiller les élèves pour leur permettre de trouver place dans leur environnement, plutôt que de construire des mondes étanches autour d’eux. « Notre objectif, c’est de les faire gagner en souplesse et pas l’inverse, et d’essayer de voir en quoi leurs propres stratégies peuvent faciliter leur intégration », insiste la thérapeute, pour qui il n’est évidemment pas question de culpabiliser les parents de vouloir aider leurs enfants, ni de forcer ceux-ci à accepter un système qui ne leur correspond pas.
Mais il lui parait urgent de « dépsychiatriser » la relation que notre société entretient à l’univers scolaire, de manière à réserver cette forme de prise en charge à celles et ceux qui n’ont pas les moyens de faire autrement, comme les personnes Asperger, qui n’ont que très peu de chances de réussir à s’épanouir dans un cadre classique…
Vous avez aimé cet article ou bien vous voulez réagir ?